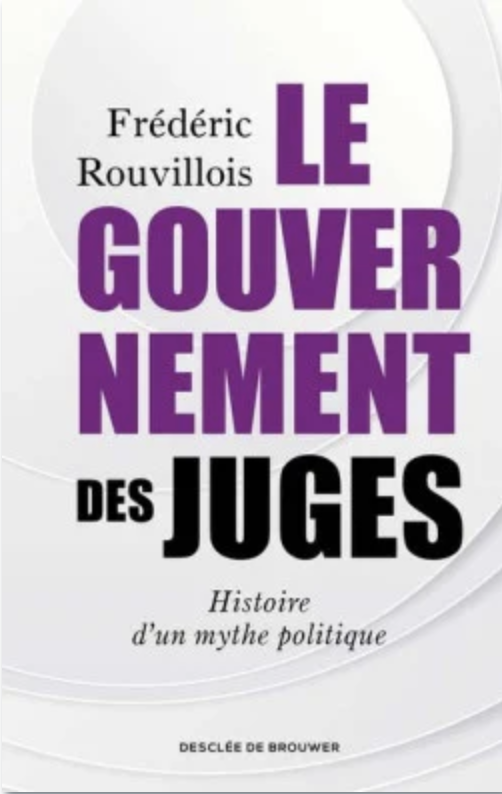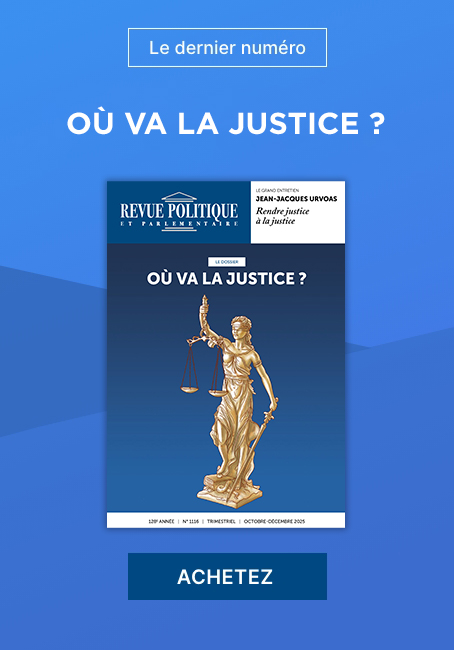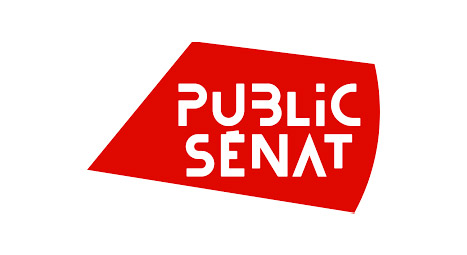Le gouvernement des juges de Frédéric Rouvillois
Les éditions Odile Jacob viennent de publier un nouveau livre du juge émérite à la Cour suprême des Etats-Unis, Stephen Breyer, tout simplement intitulé Interpréter la Constitution américaine et sous-titré La lettre ou l’esprit. Avant, prochainement, de rendre compte de cet ouvrage, et pour, déjà, montrer que l’alternative susdite n’existe pas – l’esprit et la lettre s’interpénétrant inéluctablement, que le juge le veuille ou non, qu’il en ait conscience ou pas – il nous faut, comme une introduction à cette future chronique, rendre compte d’un précédent livre du constitutionaliste Frédéric Rouvillois.
Il existe une recherche fondamentale en droit. Mutatis mutandis, elle est encore contrainte d’en demeurer à la physique classique, à Descartes, Newton, à la science descriptive, à Linné et à la méthode expérimentale du XIXè (Claude Bernard). Cette approche, quel que soit le nom que l’on lui attribue (philosophie du droit ou théorie du droit), s’apparente à de l’ingénierie juridique. Elle ne peut prétendre s’attaquer au fin fond des choses à partir du moment où elle n’intègre parmi ses paramètres si ce n’est le contenu des différents droits naturels envisageables, au moins le principe de l’existence de ce droit naturel. Mais, de même que la matière, la nature en général ne peuvent être appréhendées uniquement par les sciences naturelles, le droit ne peut faire fi de son soubassement ultime (le droit naturel). L’ingénierie juridique (incluant, entre autres matières, dogmatique juridique, logique juridique etc) est au droit positif ce que la métaphysique (doctrines, idées politico-juridiques etc) est au droit naturel. La physique classique est incapable de relier ces deux branches, ces deux approches pourtant inséparables ; pour ce faire, il faudrait pouvoir transposer à la matière juridique un équivalent de la mécanique et de la physique quantiques. En l’état, ce n’est pas le cas. Si bien que tout ce que l’on peut en dire à ce jour est approximatif, très éloigné de la réalité effective. On devra donc se contenter de quelques remarques superficielles sur le livre susvisé, lesquelles pourraient être tant une préface qu’une postface à l’ouvrage.
- « Faire le droit, c’est en justifier le fait.» : c’est là, de la part de Pierre Magnard (Questions à l’humanisme, PUF puis Cerf), un bon résumé du positivisme.
- Kelsen, Théorie générale des normes, PUF, p. 358 appuie la position/constatation expérimentale que toute norme est un ‘‘blanc-seing’’ de fait donné au juge (cf. aussi note 185, p. 580).
- Kelsen, Théorie générale…, p. 349, op. cité : « La norme habilitante est une norme de blanc-seing.» Empiriquement, de plus, ce sont toutes les dispositions normatives qui s’avèrent se comporter comme des normes habilitantes : de fait, le juge édicte ce qu’il veut.
- Couramment, communément, on se représente un système juridico-étatique (expression redondante) comme une pyramide de normes hiérarchisées, la plus haute étant la constitution de l’Etat. Mais c’est sous la figure d’un cercle que s’articulent les normes en démocratie, un cercle formant un diallèle c’est-à-dire un cercle vicieux.
- Un exemple de ces innombrables difficultés logiques est que : « […], de ce que la validité provient du processus de production de normes inférieures, il résulte non que la hiérarchie est inversée, mais seulement qu’elle doit être considérée comme interne au discours de l’interprète.» (Michel Troper, La théorie du droit, le droit, l’Etat, PUF, 83).
- La toute-puissance de cet interprète – qui est donc le juge – se voit encore renforcée, l’expérience montrant une fois encore que c’est la théorie réaliste de l’interprétation qui est vraie : la norme, quelle qu’en soit sa clarté, ne contient un pas sens unique, évident, incontestable ; la norme n’existe qu’en tant que norme interprétée. L’interprète ne puise pas en elle une matière (un contenu) qui serait déjà présent en elle ; c’est le sujet interprétant (le juge) qui projette le sens sur le texte ou, plus exactement, à l’intérieur de la norme. C’est le juge qui subjectivement décide de ce que la norme prétendument objectivement veut. Mais la norme en elle-même n’a pas de volonté : à la lettre, elle ne veut rien dire. (La théorie inverse dira que le juge-interprète au contraire extirpe le sens prétendument déjà contenu dans le texte). La théorie dite réaliste de l’interprétation juridique correspond à ce qu’est le nominalisme au sein de la fameuse Querelle des Universaux au Moyen-Âge : il n’y a pas de Vrai objectif, ou, du moins, derrière le mot « vérité » ne se cache pas le Vrai en soi, ou l’Idée du Vrai (contrairement à ce que soutenait Platon).
- En ce qui concerne l’interprétation de la norme nommée « constitution », la théorie de l’interprétation dite « interprétativiste » se rattache à ladite théorie réaliste de l’interprétation (cf. supra 6), à ceci près que le sens projeté sur la norme sera tiré du présent, de l’actualité, de l’ « esprit du temps » (die zeit).
- Pareillement, la théorie inverse de l’interprétation de la constitution dite « originaliste » soutient que c’est le sens originel, le sens qui était celui donné au moment de l’élaboration et de l’édiction de la norme constitutionnelle qui perdure de manière intemporelle, qui est fixée et doit demeurée fixe. Le relativisme n’est pas ici une doctrine : la norme par définition prime et primera toujours le fait, lequel ne peut jamais faire jurisprudence. Seulement, simplement, convient-il d’appliquer – c’est-à-dire ici : mettre en relation – une norme adoptée en un temps où le cas ne se posait pas à des faits de tous ordres nouvellement apparus.
- Plus, historiquement et hiérarchiquement, ce que nous appelons « la chaîne de commandement des normes » s’étire, plus chacune des normes qui la composent (et la constitution au premier chef) acquière-t-elle de possibilité/capacités interprétatives.
- – Par exemple, historiquement, bon nombre des ordonnances royales, des arrêts de règlement revêtus par le Roi de lettres patentes, le droit romain applicable jadis dans les pays de droit écrit, ailleurs les coutumes de l’Ancien droit font partie des sources du droit (cf. Jacques Boré, La cassation en matière civile, Dalloz, 1997, pp. 231 et suivantes) ;
- – Mais ce qui est vrai de manière extensive l’est tout autant de manière intensive : la notion de « norme vivante » s’applique pareillement à la norme constitutionnelle envisagée tant sous l’angle originaliste que sous l’angle interprétativiste. Seules diffèrent l’origine de ladite « vie », les sources auxquelles elles s’abreuvent et ainsi tout ce qu’elles charrient, impliquent et prétendent justifier.
- – Si on assimile la norme « constitution » et ses dispositions au pendant, dans l’ordre juridico/étatique civil, du dogme dans l’ordre ecclésial, l’authentification de l’interprétation de la constitution d’un Etat selon la théorie originaliste – c’est-à-dire celle qui estime qu’une constitution doit être interprétée selon l’intention initiale du constituant (et non selon la pensée de l’interprète à un instant t de l’interprétation) – pourrait reposer, ou s’inspirer des principes que doit respecter l’Eglise catholique romaine pour, non pas inventer mais seulement développer sa doctrine à la manière d’un génome s’accroissant toujours de manière fidèle à son génotype. Il n’y aurait de la sorte jamais de changement, mais une simple évolution à l’intérieur d’un cadre doctrinal dé-limitatif ;
- – Si l’on se persuade donc, en outre, 1/ qu’il n’y a pas de séparation effective des pouvoirs « à la Montesquieu » – la norme législative, à l’occasion de chaque procès/de chaque prononcé de décision judiciaire, se dédoublant en quelque sorte ou, plus précisément, ne devenant effective qu’appliquée/interprétée à une espèce, 2/ que le juge, le voudrait-il, ne peut (ne serait-ce que techniquement/pratiquement) se contenter d’être « la bouche de la loi », 3/ qu’il suffit que les deux juridictions les plus élevées d’un Etat disposent, chacune, de normes d’extension de compétence de fond opposées pour que s’instaure alors entre elles un jeu, possiblement sans fin, de « ping-pong » les neutralisant mutuellement et rendant, à terme, le système juridico-judiciaire non fiable, non viable et « impraticable », il demeure toutefois quelques remèdes… théoriques.
- – 1/ En revenir à l’esprit du Tribunal de cassation de 1790 qui se limite à contrôler non pas l’interprétation mais uniquement l’application de la loi ; ce retour paraît toutefois difficile, ce, en premier lieu parce que, comme on l’a vu au § 6, toute norme effective est une norme préalablement interprétée, en second lieu, parce que cette autolimitation n’aurait d’intérêt que si aucune juridiction supérieure à ce tribunal de cassation n’était maintenue ;
- – 2/ Enumérer dans la constitution (ou texte annexe de même valeur) tant l’esprit que la lettre des dispositions générales sur lesquelles la juridiction constitutionnelle ne saurait se fonder pour effectuer son contrôle de constitutionnalité (cf. F. Rouvillois, op. cité supra, p. 53) et, parallèlement, 3/ ne conserver que l’exception de constitutionnalité (dont le recours serait restreint) (suppression du contrôle de constitutionnalité d’une loi qui vient d’être votée) exercée dans l’esprit de Duguit (cf. op. cité p. 75) ;
- – 4/ Briser le diallèle en édictant la responsabilité non pas pénale ni même civile de la cour suprême constitutionnelle d’un Etat devant le peuple, mais sa responsabilité politique. On aurait là la possibilité de l’exercice d’un droit de veto dont le peuple pourrait faire usage à l’encontre de ce type de juridiction outrepassant ce qui était au départ sa légitime compétence d’interprétation, et une inédite transposition à la fonction judiciaire de la responsabilité politique de l’exécutif. Le juge judiciaire s’étant comporté à l’égal d’une autorité législative, il serait ainsi naturel, sinon logique, que le peuple porte sur lui le regard qu’il porte sur le législateur (les parlementaires) élu par lui, en ayant la possibilité de le renvoyer, le peuple ayant donc – si l’on peut résumer ainsi le processus alors à l’œuvre – le pouvoir de prononcer le dernier mot, de dire son fait à l’instance qui n’aura pas dit le droit.
Autrefois, estimait-on couramment, détenir le pouvoir, c’était être Président de la République, ou Premier ministre (selon la nature du régime), c’était être directeur du quotidien Le Monde ou « arbitre en chef des élégances » dans toutes les disciplines, soit, selon les échelons de pensée, l’intellectuel-gourou mainstream (de nos jours : « l’influence » à trois neurones mais aux millions de « vues »). Aujourd’hui, pèse, joue dans la survenue et l’effectivité de la décision proprement politique essentiellement la pensée personnelle, la pensée propre (qui est en elle-même un bras armé) du Premier Président de la Cour de cassation, du Vice-président du Conseil d’Etat, du Président du Conseil constitutionnel, du Président de la Cour suprême des Etats-Unis et de ses autres membres. Une guerre civile larvée/civilisée, une guerre de clans règne au sein de ces cénacles (qui ne sauraient aujourd’hui autrement se comprendre que comme des sociétés de pensée essentiellement politiques).
La mésentente intellectuelle des juges américains Ginsburg et Scalia les rassemblaient à l’extérieur sous l’égide des bons gâteaux de monsieur Ginsburg. Mais, ce qui est possible à un échelon restreint ne peut l’être à vaste échelle. Comme l’a bien vu la pensée juridique positiviste – et comme ne peut pas ne pas le voir la simple logique juridique – la crise de la démocratie est une crise du principe d’imputation des normes, lequel principe est au fondement de la Souveraineté (cf. Michel Troper, La Souveraineté comme principe d’imputation, in La nouvelle Union européenne, s.-d. O. Gohin et Armel Pécheul, éd. F.-X. de Guibert, 2005). Puisqu’il n’y a pas d’entité territoriale (unifiée et indivisible dans sa structure juridico-judiciaire), adossée à/formalisée par/ un ordre juridico-politique par définition unique qui serait dénommée « Union européenne » ou « Monde » ou par quelque autre nom, c’est en dernière instance toujours le souverain de/dans l’Etat qui est compétent pour dire le droit qui le regarde, c’est-à-dire qui doit s’appliquer sur le territoire coïncidant nécessairement avec le dit « Etat ». Autrement dit, puisqu’il n’y a pas d’Etat européen, l’ordre juridique de l’UE ne peut pas, à tous points de vue (dont le point de vue de la logique pure), être analysé autrement qu’inférieur à l’ordre juridique de chacun des Etats membres, ainsi que l’a reconnu, pour l’Allemagne, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Et, dans ces conditions, le peuple de chaque Etat – mystérieuse articulation du peuple ethnos et du peuple demos, les deux branches se définissant réciproquement –, ainsi que les normes que ce dernier vote et édicte (directement ou par le biais de ses représentants) peuvent toujours décider d’avoir le dernier mot (c’est-à-dire : juger définitives les normes qu’il vote et édicte directement ou par le biais de ses représentants) puisqu’il peut toujours soit supprimer l’instance juridictionnelle suprême, soit en modifier la composition.
Frédéric Rouvillois ne dit pas explicitement qu’il est en réalité favorable à ce « gouvernement des juges » à condition qu’il s’exerce, si l’on peut dire, sous la férule, l’emprise supraconstitutionnelle (spirituelle) d’un droit naturel par essence conservateur (d’une essence traditionnelle). Mais, en citant en conclusion tout à la fois Kelsen et Troper (adeptes du droit pur positif) et Pierre Manent (loi naturelle), il laisse à entendre que la solution du problème ne peut en premier lieu que provenir d’une compréhension exhaustive, parfaite du fonctionnement de ces deux ensembles connexes et inséparables que sont à la fois l’Etat et le « peuple ».
Hubert de Champris
Frédéric Rouvillois
Le gouvernement des juges
Desclée de Brouwer
258 p., 18,90 €.
Les derniers articles
Les maires et le logement: le cauchemar du vieillissement du parc
Les programmes des candidats aux municipales comportent tous cette fois un volet logement significatif et distinctif. L’essentiel y est le...
Turbulences en Méditerranée orientale
La Méditerranée orientale représente un modèle de turbulences actuellement aggravées par la guerre israélo-américaine décrétée contre l’Iran. Cette région, où...
Première étude : Ecologie : le non-dit
Cette analyse invite à regarder autrement nos débats contemporains : quelles idées d'aujourd'hui deviendront demain si banales qu'on oubliera leurs...